DESILLUSIONS PERDUES:
Une Education de Lone Scherfig
scénario de Nick Hornby
(2009)
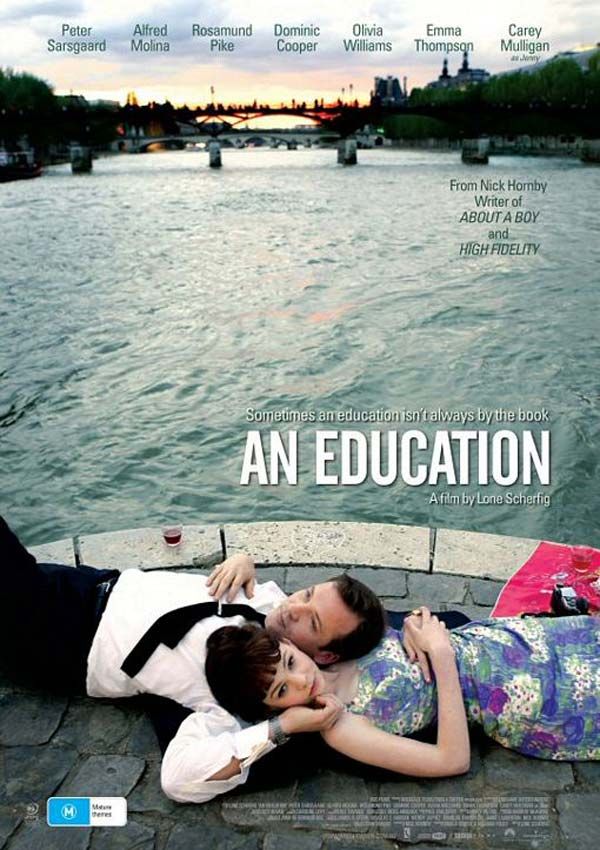
Une Education tend à résoudre l’opposition fondamentale entre le domaine
du physique et celui du spirituel, entre la beauté et l’intelligence (énoncée,
avec subtilité, tout le film durant) : c’est-à-dire abolir la frontière
entre d’un côté l’art (Burne-Jones, Ravel, le jazz…), l’amusement, le panache,
la joie de vivre, l’amour, et de l’autre l’éduction, synonyme d’ennuis et de
contraintes, qui est liée chez le père et la directrice du lycée à une forme de
réussite sociale, à l’argent, et au mariage.

Chez l’héroïne du film,
l’éducation correspond vite à une circulation des savoirs vide de sens,
purement sociale et conventionnelle, un parfait conformisme – le générique
l’illustre bien en faisant s’alterner des scènes d’enseignement traditionnel
(littérature, mathématiques…) et de savoir-vivre (maintien, cuisine, etc.),
mettant ainsi ces deux savoirs au même niveau, dispensés pour atteindre le même
but aseptisé : celui d’enfermer les jeunes filles dans un rôle qu’elles
n’ont pas choisi et que la société leur impose. D’ailleurs, à plusieurs
reprises, Jenny est filmée dans sa chambre en train d’étudier, et la mise en
scène stigmatise le motif de l’enfermement, d’abord parce que la caméra est dès
lors située à l’extérieur, et puis parce que de cette façon on voit le
personnage à travers le prisme d’une fenêtre aux carreaux étroits, rappelant
les barreaux et le grillage d’une prison. La question récurrente du latin
insiste aussi là-dessus, car c’est finalement la matière par essence la plus
scolaire, imposée par la tradition et l’institution, et qui met le plus en
péril l’avenir universitaire de l’héroïne. A la vanité de telles connaissances
répond le dérisoire de leur finalité : « Il n’y a pas que
l’enseignement, il y a aussi l’administration » - telles sont les
perspectives d’avenir que propose la Principale à Jenny. Le dilemme est alors
vite résolu, puisque comme souvent ce sont les choses les plus amusantes qui
possèdent le plus de sens. Jenny affirme que sa famille n’accorde aucune
importance aux « loisirs » (« nous n’y croyons pas », dit
même le père), alors que David rétorque que c’est justement leur futilité qui
les rend si intéressants. Dès lors, le mouvement du film visera à résorber
l’opposition belle écervelée / étudiante boutonneuse, telle qu’elle est énoncée
avec tant de spiritualité à l’occasion du séjour à Oxford.

Le rôle de la professeure de
lettres est crucial à cet égard. C’est elle qui pose le problème en des termes
on ne peut plus clairs (« tu es intelligente et tu es belle, tu peux tout
faire »), et c’est dans son appartement que l’opposition qui a dirigé tout
le film se résout. Chez ce personnage (que Jenny place tout au long du film du
côté de l’éducation, de l’ennui, du rigorisme anglais), l’héroïne trouvera un
piano et surtout une reproduction de Burne-Jones, et puis d’autres copies de
tableaux, et des livres de poche, et leur simple présence suffira à annuler la
dichotomie. La scène est clé, car elle ne marque pas un retournement, le
triomphe de l’ennui, mais plutôt la fusion des deux pôles énoncés plus haut et qu’on
pensait opposés.

Avant de parvenir à cette
résolution, l’influence de David tend à réduire Jenny à un objet, une belle
chose, vieux fantasme machiste habilement restauré dans le film, qui conduit
l’héroïne au bord de la réification. Lors de leur première rencontre, David dit
s’inquiéter du violoncelle de la jeune fille plutôt que de sa personne, et
c’est lui qu’il met aussitôt à l’abri de la pluie – or, il est bien connu
depuis Man Ray que la forme du violoncelle rappelle celle du corps féminin, et
la métaphore dévoile dès le départ les considérations purement physiques du
personnage. D’ailleurs, David estime la valeur de l’instrument et le monnaye
avant de l’embarquer dans sa voiture : l’allusion à la prostitution est
alors transparente. Le comparse de David traite sa blonde de la même manière,
comme une chose, et quand il présente son appartement à Jenny, il lui dit
« comme tu peux le voir, j’aime beaucoup les objets », dans un geste
qui inclue la jeune femme, il est vrai un brin évaporée. D’ailleurs, il possède
lui-même un violoncelle extrêmement rare et précieux dont il ne joue pas, mais
qu’il expose, le réduisant au simple rang de babiole, et non plus à celui d’instrument
prestigieux – probable métaphore de la belle blonde. La plupart des objets dont
il est question sont uniques, précieux, authentiques, originaux, et notamment
les objets d’art (le tableau de Burne-Jones, la carte du 16ème, etc.)
– et il s’agit là d’une ultime métaphore possible se rapportant à Jenny,
évoquant par écho sa virginité, qu’elle ne peut perdre qu’une seule fois, et
lors d’une occasion unique (son anniversaire), défloraison qui sera d’ailleurs
reportée, car pas vraiment naturelle (David veut substituer à son sexe une
banane, ultime et ironique réification) et source de désillusion. En réalité,
et à l’inverse, comme dans l’appartement de l’enseignante, le bonheur se trouve
dans la répétition, la reproduction, la copie : « c’est ce qu’il
faut », note Jenny.

C’est encore ce qu’elle exprime
encore en voix-off à la fin du film, par un autre jeu d’écho, avec sa toute
dernière phrase : « Je lui ai dit que j’adorerais voir Paris, comme
si je n’y étais jamais allée », qui rappelle par contraste « les
premières fois n’arrivent qu’une seule fois ». Le film se clôt en somme
sur l’idée que les premières fois se produisent aussi longtemps que perdurent
l’enthousiasme et l’émerveillement. En ce sens, « l’éducation » que
relate le film ne se résume pas à la perte de l’innocence (voir Paris, c’est un
peu comme Venise, c’est mourir d’une petite mort, métonymie du dépucelage),
mais c’est presque l’inverse, c’est l’apprentissage d’un émerveillement
toujours renouvelé, comme si Jenny avait ainsi atteint une virginité éternelle.
Le film repose donc sur un récit
initiatique, et le terme « éducation » abonde très largement dans ce
sens. Et comme dans tout bon récit initiatique, il existe aussi dans le film
une ambivalence entre illusion et désillusion, qui décline autrement la
dichotomie intelligence / beauté. Il n’y a qu’à observer le comportement des deux
hommes, arnaqueurs de haute volée dont les « coups » relèvent de la
prestidigitation (voir la carte avec laquelle ils partent d’une maison d’Oxford)
et dont l’attitude et le mode de vie renvoient à une dimension explicitement
magique et théâtrale (la salle de concert, la salle de restaurant,
l’appartement du copain sont des décors caractérisés par leur ambiance assez
baroque, presque surnaturelle). Ainsi, de ce côté, l’illusion est donc complète,
et David, maître ès manipulations et mensonges, transforme tout ce qu’il touche
en artifice, chaque chose le concernant étant frappée du sceau de la fausseté
et du toc : entre autres la signature usurpée de C.S. Lewis, la fausse
demande en mariage (caractérisé par l’absence de bague – autre tour de
passe-passe s’il en est), jusqu’à la banane qu’il propose à Jenny pour la
déflorer, et dont je laisse apprécier l’artificieux usage dans le contexte.

Le passage à Paris en est
d’ailleurs assez significatif, parce que les images du séjour se situent dans
la plus pure lignée de la carte postale hollywoodienne, c’est-à-dire très
jolies et très propres, typiques, et
figées d’ailleurs à plusieurs reprises par l’appareil photo de David qui
suspend le film et sa réalité à une image éphémère et trompeuse. C’est bien
d’ailleurs tout le rôle de ce personnage au fil de l’histoire : suspendre
la vie de l’héroïne à un songe, une rêverie sans plus de réalité et de
profondeur qu’un cliché – au sens propre comme au figuré. Le jeu sur l'appareil
photo et les images qu’il produit – comme toutes les images auxquelles David
est assimilé : la carte, le livre de Lewis illustré, le tableau de
Burne-Jones – caractérise le « miroir aux alouettes » que ce Dom Juan
de pacotilles représente pour la jeune fille : une image désincarnée, sans
substance. On rappellera encore plus tard le rôle que joue une référence au
roman L’Etranger d’Albert Camus dans
le film, mais à travers ce qu’on vient d’évoquer, on peut d’ores et déjà tisser
un lien étroit entre l’insensibilité pathologique du personnage de Meursault
chez Camus et celle de notre Casanova, qui préfère satisfaire ses besoins matériels
immédiats plutôt que s’inscrire dans la durée et dans l’affect. Cette
particularité donne de David une image instantanée, fixe, figée, dénuée de
profondeur (il a toujours sur le visage la même expression, qui lui donne le
charme d’une figure de cire), une image donc quasi photographique (on le voit
assez peu en mouvement, souvent assis, allongé, statique) opposée à l’image
cinématographique que représente Jenny.
En effet, celle-ci se caractérise au contraire par le mouvement, la marche, la
course, la danse – en somme, une véritable petite image-mouvement deleuzienne
incarnée. La première rencontre avec David est d’ailleurs symptomatique :
tandis que Jenny marche sur le trottoir, accompagnée par un travelling latéral
qui en redouble le déplacement spatial, l’homme la suit en restant immobile
dans sa voiture, filmé dans le cadre resserré de la portière, donnant
l’impression qu’il ne bouge pas du tout, illusion seulement démentie par le
champ / contrechamp de la conversation. Il finit par enfermer Jenny dans le
hiératisme assimilé ici à l’automobile, dans l’évanescence de ce monde réduit à
un vaste décor de théâtre, dans le cadre des photographies l’emprisonnant au
sein d’une vie qui n’en est que l’illusion. Le cinéma joue alors avec sa propre
grammaire, incarnant la vie et le réel dans le mouvement, tandis que l’immobilité
à laquelle il s’oppose représente le faux-semblant, le trompe-l’œil.

Tout l’enjeu du film ne sera donc
pas tant pour Jenny de conquérir son droit à vivre dans l’illusion (qu’elle
revendique pourtant à plusieurs reprises comme étant une chance inespérée,
qu’elle oppose à la tristesse d’une vie d’études, de concessions et de
dévouement matrimonial), mais bien plutôt au final de concilier celle-ci avec la
réalité. Si elle fait l’expérience du faux (elle aussi manipule ses parents),
elle reste de plein pied dans le réel, comme si elle y était intrinsèquement
liée. Ce qui occasionne d’ailleurs une des plus belles séquences du film, quand
le père parle à sa fille à travers la porte de sa chambre restée close et qu’il
raconte que lors d’une émission à la radio il a appris que C.S. Lewis vivait à
Cambridge et non à Oxford, ce qui lui inspira la remarque : « ils
doivent se tromper, car sinon, comment notre petite fille aurait pu avoir sa
dédicace ? » : le mensonge n’est pas envisageable chez Jenny,
comme si elle avait le pouvoir de rendre l’illusion réelle. La référence au
livre de Lewis, Le Lion, La Sorcière
Blanche et L’Armoire Magique, n’est d’ailleurs peut-être pas anodine :
sorte de relecture d’Alice au pays des
merveilles, il raconte le passage de la réalité au monde merveilleux de
Narnia. Narnia, Paris, Oxford, même combat : on a là la topographie d’une
utopie promise au bonheur dont l’héroïne veut réaliser l’exploration. Mais le
rêve ne se conquiert pas aussi facilement qu’en traversant le miroir ou qu’en
entrant dans une armoire magique. C’est alors ce qu’elle apprend à ses dépens.
La lucidité de la jeune fille apparaît aussi à l’occasion d’une autre référence
littéraire : L’Etranger d’Albert
Camus, qui occasionne un dialogue fort symbolique entre les lycéennes. L’une
d’entre elles se fait la réflexion que si sa mère venait à mourir, elle ne
ressentirait rien, et se demande si cela ferait d’elle une existentialiste, et
l’héroïne lui répond : « ça ferait de toi une vache ». La
dimension romanesque se dissipe face au réalisme de Jenny, et la réalité du
quotidien reste incoercible face à la morale du récit de Camus, pourtant reconnue
par elle – l’armoire est alors verrouillée de l’intérieur. La lucidité se mue
même en désillusion, lorsqu’elle compare « tous ces poèmes, toutes ces chansons,
tous ces livres, toutes ces peintures » (soit le monde de l’illusion) à
« une chose si courte » (soit la réalité de David, piètre amant,
réduit à deux dimensions seulement).
Dur retour à la réalité, donc :
l’amant n’était pas sérieux, les rêves d’évasion de la jeune fille sont réduits
à néant. Mais la propre morale du récit se fait alors jour : c’est en
renouvelant la première fois qu’on est capable de se prémunir des déceptions – tout
reste toujours à conquérir. Ainsi, il n’existe pas de désillusion possible.
Comme par un tour de magie, le seul véritable prestige du film, il suffit de
plier le temps à sa convenance et de restaurer un nouvel ordre des événements,
ce que le film révèle avec justesse à travers l’ellipse finale, où une année d’études
solitaires passent en quelques secondes. Le réel devient alors le terrain de
jeu de l’illusion, le champ de tous les possibles – idée splendide, et
proprement cinématographique, au demeurant – mais qu’il conviendrait d’appliquer
chaque jour à nos propres existences.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire